L'APPROCHE (lettre à Gabrielle)
Par simple appareil le jeudi 30 octobre 2008, 11:13 - parallèles - Lien permanent
Tags :
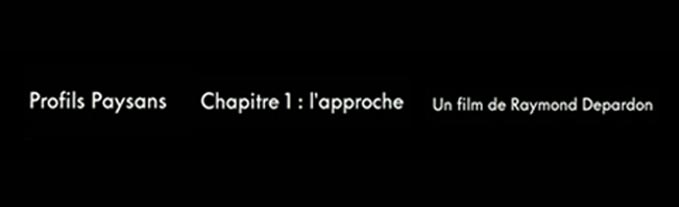
Quelques réflexions sur le tournage et l’approche des personnes filmées, à partir de la série Profils paysans, de Raymond Depardon.
« Il y a du tragique chez les paysans, et il y a du tragique chez nous aussi à filmer ça, on est dans cet état d’esprit, on va chez les gens, on les dérange, on marche sur des œufs, c’est un peu sacré cette image, cette beauté, cette émotion[1]. »
« Après le premier film, L’Approche, Thierry Garrel (alors responsable du documentaire sur Arte) m’a reproché dans une longue conversation téléphonique de ne pas « creuser plus vite », de rester à la surface (…). Ce n’est pas une méthode de télévision, qui fait des close-up à l’américaine ; elle force les gens, elle insiste. Ça aurait été la catastrophe si j’avais fait ça, ces gens-là n’aiment pas trop être photographiés (…). Ma manière de faire a aussi été de ne pas trop m’incruster. (…) J’avais honte un peu, cette honte ressurgissait en allant dans ces fermes et je disais à Claudine : « On s’en va. » Mais de toute façon, chez ces paysans, il ne faut jamais être de trop, il faut les prévenir qu’on arrive, venir, se présenter, boire un verre avec eux, discuter, filmer et puis dégager. Je dégageais même peut-être un peu trop vite (…). Donc je suis resté d’abord en surface, en refusant le système où on commence à se faire bien avec les gens, ami ami, grande tape dans le dos, style télévision française, ça je connais et je hais, et à un moment donné on force les gens. Je ne voulais pas de ça. Le plan où Marcel Privat dit « c’est la fin » n’est possible que grâce à quinze ans de connaissance avec lui, dix ans de tournage avec lui, et aussi le fait que nous sommes toujours venus avec une caméra. Très souvent on n’a pas filmé, mais la caméra était présente dans nos discussions, pour qu’au moment de filmer elle ne soit pas d’un seul coup un objet en plus[2]. »
Ces quelques phrases de Depardon, parce que les deux premiers épisodes de Profils Paysans, « L’Approche » (2001) et « Le Quotidien » (2004), m’ont pas mal interrogé. Et parce qu’il me semblait aussi – mais de ça on a déjà parlé –, qu’il y avait là-dedans des choses qui dialoguaient avec ton projet et la manière dont tu l’abordais (la voix-off, notamment).
Je voudrais ici me pencher sur la “distance” ; je réfléchis surtout à partir de l’épisode 1 et les remarques qui suivent s’appliquent moins au « Quotidien » et à « La Vie moderne ». (C’est toutefois l’occasion de signifier que l’effet de série est passionnant : le filmeur de 1998 n’a plus rien à voir avec celui de 2007. Et, en réalité, avec Profils Paysans, Depardon documente sa manière de faire du documentaire, c’est-à-dire la manière d’engagement personnel qu’il faut pour “capter” son sujet.)

La distance, donc. Deux choses m’ont retenu. Deux élements qui ont fait que j’ai été finalement pas mal surpris par ces films, bien que j’en connaissais préalablement les procédés et les principes.
La première surprise provient de l’omniprésence de la mise en scène. Les scènes sont préparées, « jouées » d’une certaine manière (rejouées ?) – et il ne s’agit pas du tout pour Depardon de suivre ses paysans, caméra à l’épaule, dans leurs activités de paysans ; d’ailleurs il ne filme que des intérieurs : cuisines, salles à manger, c’est-à-dire les lieux de parole ; parfois des écuries.
La caméra et le cadre sont posés, puis les paysans rentrent dans le champ ou la parole débute – on entendrait presque le clap. Précision de Depardon : « On voit que c’est un plan calculé, qui est fait pour ça, mais il est avec celui que je filme, il est de son côté[3]. »
Deuxième surprise, extension de la première : l’omniprésence de la caméra, qui semble toujours le centre de la scène filmée (regards des « personnages » vers l’objectif ou par-delà, en direction d’un Depardon mutique). Cette position centrale, se dit-on, explique le malaise qui règne dans ces images. Je veux bien admettre que les paysans soient particulièrement réfractaires à l’image et au filmage, on a du mal à ne pas penser que Depardon n’y est pas pour quelque chose (mutisme donc, refus des questions, frontalité radicale – surtout dans l’épisode 1).
D’où mon étonnement : alors que le film pose explicitement la question du droit au filmage, de la manière de contact qui a été choisie (« L’Approche » – « Ce film est consacré à l’approche. Notre approche de ces fermes et de ces habitants »), les images montrent surtout une forme de maladresse : comment s’expliquer, avec toutes ces précautions prises (le temps long, les retours réguliers, l’équipe réduite à deux personnes, etc.), que les gens filmés soient si mal à l’aise ?
Ici, il faut se pencher sur le dispositif de Depardon, cette fameuse « caméra observante », à l’œuvre dans ses films précédents.
Le documentarisme de Depardon a d’indiscutables qualités :
- L’évidence à tous (filmés, filmeur, spectateurs) de la caméra ; il y a une sorte de courage à refuser la prise de vue à la dérobade, « cachée » (contre la traque télévisuelle), à assumer les principes initiaux dans toute leur rigueur (refus de la question, retrait du filmeur, l’œil de la caméra occupant l’espace vacant).
- Chaque plan a pour motif central un humain : règle élémentaire, visiblement, du montage ; les plans d’objets, de bêtes ou les paysages – clichés du documentaire campagnard – se comptent sur les doigts d’une seule main.
Forme d’austérité que rattrape cette façon de filmer les hommes et les femmes avec leur environnement immédiat, on pourrait dire « dans leur cadre » (tout aussi signifiant que les propos ou les postures). « Il me semble que j’ai gardé la parole, la gestuelle, leur présence physique, l’éclairage aussi, les lieux[4]. »
- Ce cadre de principe – je parle du « cadre » de la caméra cette fois – est donc assez large[5], il déborde des figures. Fixe, il implique par ailleurs un temps assez long (qui épouse la parole mais aussi celui de la nécessaire circulation du regard dans l’image : là encore le contre-modèle est le flux de la télévision).
Ce cadre est nettement donné comme celui de la « juste distance », c’est-à-dire une distance respectueuse du sujet filmé ; le retrait du filmeur signifie ici sa modestie. « Il y a un vrai paradoxe dans la prise de vues. Il faut regarder, ce n’est pas facile et, en même temps, tout n’est pas filmable. Il y a toujours cette histoire de distance ; et cette distance, là, elle vient du paysan. Quand on entre dans sa cuisine, on est sur une scène. Tout est observable. Tu dois choisir un bon endroit pour filmer[6]. »


Ce dispositif, un brin sévère, faut-il considérer, avec Thierry Garrel, qu’il produit un film qui « reste à la surface des choses » ?
Quelle est, au fond, son efficacité documentaire ?
Contrarié par cette distance lointaine et le refus du découpage, fort mal à l’aise à mon tour (pourquoi commencer par poser la caméra face aux gens ? pourquoi commencer par là ?), il m’a semblé à voir et revoir les films que, malgré tout, la mise en scène de Depardon, parfois malsaine, était en réalité un profond révélateur (mais peut-être pas dans le sens où lui l’exprimait.)
Le mal-être des personnes filmées produit toutes sortes de postures d’évitement, de détournement, de refus de parole, de gestes, qui sont autant de symptômes qui renseignent sur la nature profonde des liens qui existent entre eux, ou sur la vision qu’ils ont de leur propre existence.
La distance instaurée par Depardon, c’est un peu celle de la méfiance vis-à-vis des discours (même si l’un des enjeux des films, revendiqué par l’auteur, est de conférer le droit à la parole à ces paysans qui en sont si communément démunis, ou englués dans les clichés[7].)
Tout au contrôle d’eux-mêmes, ou de leurs propos, tout à leur défiance vis-à-vis de l’appareil (et de l’image d’eux-mêmes), les paysans inquiets laissent sourdre quantité de signes complexes qui font la qualité documentaire du film. Il y a donc à l’œuvre, dans le face-à-face organisé avec la caméra et l’archi-mise en scène, un principe de révélation.

C’est ici que se pose la question cruciale.
Le procédé est malsain, parce que là où Depardon tente de nous convaincre qu’il fonde son filmage sur une Approche ou un Quotidien, c’est-à-dire une morale (bien paysanne, humaniste, terrienne), il semble qu’en réalité, il assigne ses paysans (par le dispositif une fois encore, pas par la question directe[8]), qu’il quête l’aveu physique, le lapsus (qu’il retiendra, ou pas, au montage – cet autre site de moralisation du film).
Il y a quelque chose de la comparution dans le filmage de Depardon. Et c’est étrange[9] car ce qui nous est donné comme un comportement respectueux (rigueur du dispositif, position de retrait, consentement des « acteurs ») produit l’effet inverse d’un interrogatoire.
C’est un peu la face sombre de son dispositif : sous couvert de modestie et d’empathie (je suis venu, je suis revenu et je suis maintenant leur ami[10]), données comme des composantes déterminantes du tournage, c’est un peu, malgré tout, comme s’il cherchait à filmer la culpabilité. « J’ai du mal à l’avouer, mais j’ai un amour-haine de cette campagne. Finalement, c’est peut-être cela aussi être un homme d’image : travailler dans cette résistance, il y a des éloges et des comptes à rendre. Sinon, ça n’a pas vraiment d’intérêt[11]. »
Peut-être l’explication de mon malaise : l’impression que ces gens sont tous coupables de quelque chose de tû. (D’où un attrait irrésistible pour les innocents de ces films : Marcelle Brès, sa voix claire et douce, sans âge).

En toute extrémité, là où je veux en venir – et certainement le fond de la question que me pose le premier Profils paysans –, c’est que la moralisation affichée en tout chez Depardon n’a pas grande consistance – elle est de l’ordre du discours, il s’agit d’une convention passée entre tous les acteurs du phénomène film, bref une affaire de language ! La question de la morale, concernant le filmage, est probablement un problème strictement intellectuel ou pire esthético-idéologique – il n’en reste pas moins que la morale au cinéma, étrangement, est la question « moderne » par excellence[12] !
Ce qui revient à dire que faire une image, c’est, immédiatement, être un salaud. « Cinéma du diable » (mais le diable n’existe pas). Le cas Depardon est un bon exemple, car saturé qu’il est de bonnes pensées, il n’en produit pas moins – par une revanche somptueuse du cinéma lui-même, qui toujours déborde des cadres mentaux qu’on lui assigne – de drôles de gênes, d’excès à la limite de la moralité : ce paradoxe de la comparution[13]. Poser la question de la morale au cinéma, c’est presque immédiatement faire preuve d’une moralité douteuse (n’y a-t-il pas quelques dérèglements à déplacer sur la pratique cinématographique – qui plus est en le constituant en source de valorisation esthétique – ce qui relève de la relation humaine la plus commune, digne si possible : je m’adresse à des personnes, qu’en l’occurrence je filme… ?).
« Au départ, c’était un projet lié à mon enfance, mais bon, au bout d’un moment ça va comme ça, il faut changer d’échelle. A ce moment, les deux premiers films n’étaient plus exactement les deux premiers volets d’une trilogie, je les ressentais comme des essais, comme des tours de chauffe[14]. »
Le plus troublant peut-être est que Depardon semble lui-même faire ces constats. C’est ce qu’indiquerait son trajet, au long de la série, d’un Profils Paysans à l’autre. Le filmeur gagne en spontanéité et en naturel, de même que ses « personnages » gagnent en innocence apparente.
Le découpage est plus varié, la caméra plus libre, on a envie d’écrire plus « légère », le filmeur intervient dans son plan, physiquement ou par la question. Le contact est plus chaleureux ou le métier plus affirmé.
« Les hommes d’images ne doivent plus se réfugier derrière leurs images, je crois qu’il faut dire qui l’on est, ce que l’on fait, où l’on va. Il faut s’assumer. (…) Aujourd’hui, je renie cette théorie de la caméra observante, dans laquelle j’étais transparent, qui a pourtant constitué le pilier de mon cinéma. Maintenant, je participe à la prise de vues, car, avec les paysans des Cévennes, je ne peux pas rester derrière la caméra et filmer peinard. Je fais aussi des travellings, des gros plans, du scope, alors que je n’en faisais jamais non plus. La vie moderne est donc un documentaire, mais c’est aussi un film, un récit, où j’accomplis le contraire de ce que je préconisais il y a vingt ans[15] ! »
Probablement, c’est en lui-même, en l’occurrence dans son propre sentiment de culpabilité, que Depardon progresse ou évolue. L’effet de série est édifiant et Profils Paysans expose le déplacement notable de sa cinématographie. L’évolution est telle qu’on peut, avec l’auteur, parler de rupture à propos de La Vie moderne (qui pour marquer le coup perd son sous-titre) – rupture qui est donc aussi l’avortement du projet initial et de ses principes.
Depardon passe à la « Grande forme » (35 mm cinémascope, composition sonore) et elle lui permet de se lâcher, mais la gêne réapparaît ailleurs. Le film est plus ample (or l’amplitude ne va pas si bien à la paysannerie : La Vie moderne, ça devient vite l’éloge de l’ancien temps), plus humaniste et parfois mièvre, mais moins fort cinématographiquement, certainement parce que moins ambigu – le 35 mm ne fait pas le cinéma, mais on était au courant.
Nous revoilà au point de départ : quel drôle de film que « L’Approche », sévère, complexé (moral) mais, par devers, bien plus intensément descriptif.
Notes
[1] Raymond Depardon, Claudine Nougaret, « Entretien », Cahiers du cinéma, n° 638, octobre 2008, p. 14.
[2] Raymond Depardon, Claudine Nougaret, op. cit., pp. 11-12.
[3] Raymond Depardon, Claudine Nougaret, op. cit., p. 15.
[4] Raymond Depardon, Claudine Nougaret, op. cit., p. 15.
[5] Dans le premier film, il y a un refus total du gros plan.
[6] Raymond Depardon, « Raymond Depardon ou le sens inné des distances », TGV magazine, n° 109, octobre 2008, pp. 76-77. Ici p. 76.
[7] Depardon leur donne « l’apparaître » au sens précisé par Georges Didi-Huberman, « Comment exposer les peuples ? », séminaire 2008-2009, EHESS.
[8] Quoique le troisième film, “La vie moderne” (2008), soit plus nettement autoritaire : Depardon, plus proche de ces gens, qui revient en ami, filme de beaucoup plus près, jusqu’au gros plan insistant et interrogatif, et se met en scène physiquement ; cette fois, il interroge directement ses interlocuteurs et contraint davantage la parole. « Je ne suis plus avec une « caméra observante », je suis obligé d’être moitié observant, moitié participant, alors je me suis dit : « Raymond il faut que tu y ailles, c’est toi qui nous introduis dans ces fermes, ne sois pas hypocrite, ne vas pas te réfugier derrière la caméra comme si tu n’étais pas là, on voit bien que tu es là. Tu nous emmènes chez ces gens-là, c’est toi qui les as choisis, on voit bien qu’il y a un casting d’une force incroyable, pourquoi tu as pris ces paysans qui parlent pas, d’autres qui parlent beaucoup, d’autres qui ont du mal à sortir leurs mots, il y a un autoportrait là-dedans. » Pour la première fois, j’ai une caméra qui parle. Claudine m’a dit « Ca suffit de parler seulement après, sur la voix-off… » Raymond Depardon, Claudine Nougaret, op. cit., p. 13.
[9] Pas tant que ça au vu de son œuvre antérieure.
[10] Mais combien de fois faut-il revenir, combien de temps faut-il passer avec ces gens, pour avoir le droit de filmer ? Pourquoi ne pas vivre avec eux ?
[11] Raymond Depardon, « Raymond Depardon ou le sens inné des distances », op. cit., p. 77.
[12] Voir Serge Daney, « Le travelling de Kapo », Trafic, n°4, automne 1992. « Au nombre des films que je n’ai jamais vus, il n’y a pas seulement Octobre, Le Jour se lève ou Bambi, il y a l’obscur Kapo, film sur les camps de concentration, tourné en 1960 par l’italien de gauche Gillo Pontecorvo. Kapo ne fit pas date dans l’histoire du cinéma. Suis-je le seul, ne l’ayant jamais vu, à ne l’avoir jamais oublié ? Car je n’ai pas vu Kapo et en même temps je l’ai vu. Je l’ai vu parce que quelqu’un, avec des mots, me l’a montré. Ce film, dont le titre, tel un mot de passe, accompagna ma vie de cinéma, je ne le connais qu’à travers un court texte : la critique qu’en fit Jacques Rivette en juin 1961 dans Les Cahiers du cinéma. C’était le numéro 120, l’article s’appelait « De l’abjection », Rivette avait 33 ans et moi 17. Je ne devais jamais avoir prononcé le mot « abjection » de ma vie. Dans son article, Rivette ne racontait pas le film, il se contentait, en une phrase, de décrire un plan. La phrase, qui se grava dans ma mémoire, disait ceci : « Voyez cependant, dans Kapo, le plan où Riva se suicide en se jetant sur les barbelés électrifiés : l’homme qui décide à ce moment de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d’inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n’a droit qu’au plus profond mépris ». Ainsi, un simple mouvement de caméra pouvait-il être le mouvement à ne pas faire. Celui qu’il fallait – à l’évidence - être abject pour faire. A peine eus-je lu ces lignes que je sus que leur auteur avait absolument raison. Abrupt et lumineux, le texte de Rivette me permettait de mettre des mots sur ce visage de l’abjection. Ma révolte avait trouvé des mots pour se dire. Mais il y avait plus. Il y avait que la révolte s’accompagnait d’un sentiment moins clair et sans doute moins pur : la reconnaissance soulagée d’acquérir ma première certitude de futur critique. Au fil des années, en effet, « le travelling de Kapo » fut mon dogme portatif, l’axiome qui ne se discutait pas, le point limite de tout débat. Avec quiconque ne ressentirait pas immédiatement l’abjection du « travelling de Kapo », je n’aurais, définitivement, rien à voir, rien à partager. Ce genre de refus était d’ailleurs dans l’air du temps. Au vu du style rageur et excédé de l’article de Rivette, je sentais que de furieux débats avaient déjà eu lieu et il me paraissait logique que le cinéma soit la caisse de résonance privilégiée de toute polémique. La guerre d’Algérie finissait qui, faute d’avoir été filmée, avait soupçonné par avance toute représentation de l’Histoire. N’importe qui semblait comprendre qu’il puisse y avoir – même et surtout au cinéma - des figures taboues, des facilités criminelles et des montages interdits. La formule célèbre de Godard voyant dans les travellings « une affaire de morale » était à mes yeux un de ces truismes sur lesquels on ne reviendrait pas. Pas moi, en tout cas. »
[13] Alors, souvent, l’« humanité » sert à tout justifier. Comme dans l’expression « j’ai tenté de rendre leur humanité » – comprendre : « leur part de bassesse et d’ambiguïté ». Il n’y a de morale qu’à l’instant qu’il y a de l’humain. Je me ferais facilement le chantre de la caméra inhumaine. C’est d’ailleurs à ça que nous sert la « fiction » : quand on dit faire un « documentaire fictionné » : requalifier l’humain en figure, la personne en personnage.
[14] Raymond Depardon, Claudine Nougaret, op. cit., p. 10.
[15] Raymond Depardon, « Raymond Depardon ou le sens inné des distances », op. cit., p. 76.
3 commentaires
Merci Arnaud pour ce commentaire, qui me convainc bien.
Ce qui me surprend dans le premier volet, c’est que l’unité du point de vue n’est pas si forte. Il y a bien ces moments de silences inquisitoriaux, mais il y a aussi des situations de dialogues qui paraissent plus lâchées. Peut-être les premières prennent-elles d’autant plus de relief par contraste.
Sûrement le premier volet tient-il plus du film expérimental, à condition de prendre expérience au sens scientifique, avec ce que cela suppose de violence faite à l’objet, de manipulation. Une expérience, c’est rarement drôle pour l’animal de laboratoire, mais c’est aussi un moyen d’une redoutable efficacité pour comprendre le monde…
Pour enrichir le dossier, et de façon plus factuelle : un épisode du premier film me semble particulièrement explicite.
Il s’agit du passage chez Gilberte et Abel Jeanroi (vers 1h09 min).
Ces deux-là et leur fils représentent des positions limites et critiques vis-à-vis de la posture de Depardon.
Les parents, extrêmement joviaux, refusent de se prêter au silence du réalisateur, et ne cessent de lui parler, de rire, voire de se moquer de lui. A l’inverse leur fils refuse totalement et brutalement la parole, fuyant devant la caméra.
(transcription très hasardeuse)
Abel :
Demain ils vont filmer au Bambois (?)
… la ferme du Bambois…
… c’est l’Gabaille qui vous a amné là ? non ?
Depardon (faiblement):
oui oui…
Abel (jovial) :
vous vous êtes pas arrêté auprès l’école, ça m’étonne, vous vous êtes pas arrêté ?
Si ?
Au Grioux, vous vous êtes pas arrêté à la ferme là ?
Depardon: …
Gilberte (regardant Depardon et riant) :
y peut pas causer haha…
Depardon:…
Abel (riant) :
sans parole alors ?
***
Quelques minutes plus tard, Depardon posera des questions au fils (ce qu’il fait très rarement dans le film), auxquelles celui-ci ne répondra pas.
Il ne répondra pas jusqu’au troisième volet, dix ans plus tard, où Depardon finira par le faire parler, un peu, sur son tracteur.
Victoire finale du dialogue.
Il est très difficile pour moi de répondre à l’ensemble des questions posées par Simple Appareil sur les films de Depardon et par la vidéo de Serge Daney. Le point de vue est le nœud du problème. Quel point de vue, quelle position concrète de caméra adopter, lorsque l’on tourne un film ?
Si j’apprécie le travail de Depardon dans Profils Paysans, c’est justement parce qu’à l’heure où le petit écran est farci de télé-réalité, il réactualise, à sa manière, la question cruciale du point de vue en documentaire.
L’emploi de la voix-off remet au goût du jour un « je » assumé, qui fait bien défaut dans la plupart des reportages et documentaires télévisuels d’aujourd’hui. Il n’y a plus de « je » à la télévision. On ne sait plus qui nous parle. La plupart des productions se font dans le cadre de magazines, où les comités de rédaction font la loi. Quand ce ne sont pas les comités de rédaction plus ou moins éclairés qui donnent le ton des reportages, les réalisateurs abordent le documentaire comme si c’était du journalisme, dans un souci informatif et pseudo objectif, c’est-à-dire dans la multiplication des points de vue, comme s’ils se valaient tous. Mais, concrètement, que se passe-t-il ? Les films sont réalisés dans des délais très courts, les réalisateurs écrivent un sujet et partent en tournage à la hâte, pour illustrer en image ce qu’ils ont couché au préalable sur le papier. Dans cette démarche, il y a pour moi une absence du corps. Formule étrange, je m’en explique.
Lorsque j’ai défendu le film sur les punks à chiens auprès de la production, j’ai tenu à travailler avec deux amis cinéastes, Maya Rosa et Zoltán Hauville et à étendre le tournage sur une période d’un an. C’est une question de méthode, à mon avis essentielle, qui permet de faire un travail de documentariste et donc de dépasser l’exercice de JRI (Journaliste Reporter d’Images). Or, nous sommes tous trois de bons partenaires de danse ; nous engageons nos corps dans une forme de chorégraphie avec les gens que nous filmons. Nous ne sommes pas mutiques comme Depardon. Nous prenons soin de partager l’espace, le temps et les mouvements avec les personnes filmées. C’est une fois pris dans la ronde, que nous choisissons nos partenaires, et par là même que nous déterminons le point de vue sur la scène. La caméra ne se sent pas. Elle disparaît. Le spectateur est comme absorbé dans la vie des gens filmés. Cette « caméra observante », pour reprendre l’expression de Depardon, affirme bien un point de vue, qui ne surplombe pas le ballet mais s’y intègre.
Obtenir cet effet de fluidité n’est pas facile puisque nous sommes trois, qu’il y a une perche et une caméra. Nous partageons des journées et des nuits entières avec nos « personnages », sans filmer. C’est ce temps passé avec eux « pour rien », comme dirait n’importe quel technicien de la télévision, qui nous permet d’être acceptés comme partenaires de danse. La caméra démarre finalement dans une sorte de continuité entendue avec les personnes filmées. Je ne dis pas que tout cela se passe sans heurts. Parfois les gens que nous filmons réagissent mal : « êtes-vous là en tant qu’amis, ou c’est juste le film qui vous intéresse ? », « pourquoi avez-vous toujours la caméra sur vous », « aujourd’hui je n’ai pas envie d’être filmé ! ». C’est dans ces moments, je pense, que nous essayons de rester humbles et parfois de déguerpir pour laisser les gens tranquilles dans leur intimité. Mais comme le ferait un bon ami , qui s’incruste chez vous et qui sent que vous avez envie de rester seul, donc qui s’en va en disant « à la prochaine ». Lorsque nous avons expliqué le projet du film à ceux et celles qui en seraient les acteurs, nous leur avons dit que nous voulions créer un document sur leur mode de vie. Mais comment filmer juste ?
Filmer juste, est-ce avoir de la compassion ou de l’empathie comme le dit Serge Daney ? Ce dernier terme me dérange.
En ce moment je dévore les livres de Russell Banks, dont American Darling, dans lequel le personnage principal fait une distinction entre empathie et sympathie. J’adhère à la nuance qu’elle fait entre ces deux sentiments, et je crois que lorsque je tourne, j’ai de la sympathie pour les personnes filmées, mais je souhaite éviter à tout prix l’empathie.
« Qu’y-a-t-il de répréhensible au plan éthique, ou même au plan pratique, à manifester de l’empathie pour autrui ? Pendant longtemps j’ai répondu : Rien. Rien du tout. C’est une attitude valable. Je vois un aveugle sur le point de traverser la rue et je pense : il ne peut pas voir la circulation qui file à toute allure, il a besoin que je la vois pour lui, que je le prenne par le bras et que je l’accompagne, là où manifestement il a envie d’aller. Partant de l’hypothèse que si j’étais aveugle, j’aurais besoin de moi pour m’aider, je saisis l’aveugle par le bras et je le tire, terrorisé, en pleine circulation où, non seulement je lui fais peur, mais où je le mets en danger. Parce que je dispose de ma vue, je me repose sur un certain système de guidage qui utilise principalement la vue pour s’informer et je veux à toute force la mettre à contribution. Mais l’aveugle a son propre système pour traverser. Il entend ce que je ne fais que voir, il isole des bouts d’informations qui sont perdus pour moi, et il coordonne et mémorise des données que je n’ai même pas enregistrées.
Je parle ici de la différence entre empathie et sympathie, entre sentir pour l’autre et sentir avec lui. Cette distinction a fini par prendre de l’importance pour moi. Elle en a toujours. Quand on abandonne et qu’on trahit ceux pour lesquels on a de l’empathie, on abandonne et ne trahit personne d’aussi réel que soi-même. Poussée à son degré extrême, qui peut être pathologique, l’empathie se confond avec le narcissisme. »
Cette distinction entre empathie et sympathie est devenue claire pour moi lors de notre dernier tournage. Nous sommes partis en camion, rejoindre Bitch et Little à Poitiers. Le tournage ne s’est pas très bien passé, parce que Bitch avait une nouvelle petite amie, qui trouvait notre intrusion dans leur vie un peu impromptue et qui se sentait oppressée par la caméra. Nous nous sommes donc résolus à les laisser en paix et à visiter d’autres personnes à Toulouse. Nous avons décidé de faire une halte d’une nuit vers Agen chez les parents de Zoltán, afin de nous reposer avant de reprendre la route. Sachant cela, Little nous a demandé si nous pouvions le déposer avec ses deux chiens à Toulouse. Nous étions très gênés, parce que nous ne pouvions pas l’accueillir dans la famille de Zoltán. Little ne s’en offusqua pas, mais nous demanda si nous pouvions le laisser à la gare d’Agen. Je l’ai alors prévenu que nous risquions d’arriver vers minuit, et qu’il n’y aurait probablement plus de train. Effectivement, lorsque nous sommes arrivés dans la capitale des pruneaux, la gare était fermée. Little est descendu du camion avec ses deux chiens et nous l’avons laissé seul sur le parvis de la gare. S’en est suivie une vive discussion entre nous, mêlée de culpabilité et de remords. Comment se résoudre à laisser Little dans le froid, en pleine nuit, à dormir dehors. Nous avons fini par lui proposer de venir malgré tout avec nous. Ce qu’il a refusé. Plus tard, lorsque j’ai eu Bitch au téléphone, je lui ai demandé des nouvelles de Little, et je m’excusais maladroitement. Bitch m’a ri au nez. Qu’est-ce que je croyais ? Little s’était parfaitement débrouillé, il avait l’habitude de dormir dehors ! « Y a pas de problème Gab, tu te prends la tête ! ». En fait, nous avions eu de l’empathie pour Little. Notre malaise était purement narcissique. Dormir dehors, par terre, est pour moi une souffrance, le comble de la misère, et ne l’est pas pour Little. Petite leçon de vie et de cinéma. Les vagabonds que nous filmons ne se sentent pas misérables, et nous devons les représenter sans ce regard empreint de pitié, afin d’être justes. Heureuse cette expérience, qui a permis de réaffirmer le point de vue du film.
La discussion continue ailleurs
URL de rétrolien : http://lasallepolyvalente.free.fr/punks/index.php?trackback/14
Fil des commentaires de ce billet